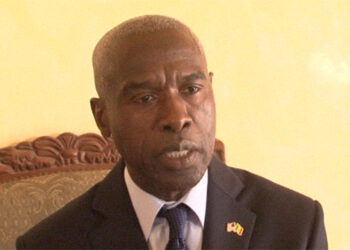Les meurtres se multiplient. La peur s’accentue. Les esprits s’échauffent. Pas un jour ne passe sans que la presse ne relaye un événement tragique affectant de tranquilles citoyens. Un mois de novembre aussi funeste, les Sénégalais peinent à s’en rappeler. Treize ou quatorze personnes ont été expédiées dans l’autre monde dans des circonstances dont la description fait pâlir de colère. Alors que les commentaires se multiplient, les propositions de loi allant bon train, une question interpelle les gouvernants : et l’Etat dans tout cela ? Entre une absence de vision, une police démunie et une Asp aussi inefficace qu’inopérante, l’Etat, qui s’est départi d’une de ses missions régaliennes, a presque abandonné les populations à leur propre sort, exacerbant fortement le sentiment d’insécurité. Dès lors, que reste-t-il de cet article 7 de la Constitution qui dispose : «La personne humaine est sacrée. Elle est inviolable. L’Etat a l’obligation de la respecter et de la protéger. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa personnalité, à l’intégrité corporelle notamment à la protection contre toutes mutilations physiques.»
L’Etat, principal responsable
«La sécurité précède le développement et le développement politique précède le développement économique». Cette assertion de Cheikh Anta Diop est loin d’inspirer les tenants du pouvoir qui se sont succédé à la tête de l’Etat du Sénégal. Et ce n’est pas par défaut d’exhortation. En effet, la Constitution sacralise la personne humaine et proclame son inviolabilité. Tout comme elle assigne à l’Etat la mission de la respecter et de la protéger. Pour y arriver, il a à sa disposition tout un dispositif, un arsenal complet fait notamment d’institutions judiciaires, d’autorités administratives et de forces de défense et de sécurité. Autant d’éléments qui poussent, à la lumière de l’actualité fortement marquée par la violence, à se poser la question de savoir : est-ce que l’Etat remplit cette mission régalienne ? Pour Boubacar Sadio, commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle à la retraite, ancien Directeur général adjoint de la Police nationale, il ne fait pas l’ombre d’un doute : «Cette mission n’est pas correctement remplie». Il en veut pour preuve les normes internationales qui sont loin d’être respectées. Au moment où il est recommandé qu’un policier assure la sécurité de mille personnes, au Sénégal, le ratio dépasse largement un policier pour 5 000 habitants, renseigne-t-il. Et si le Sénégal en est à ce niveau qu’il juge catastrophique, c’est parce qu’en presque trois décennies, le nombre de policiers au Sénégal a diminué pendant que la population triplait. «Vous imaginez qu’en 1987, on était six mille policiers, aujourd’hui, près de trente ans après, on ne fait pas six mille, malgré l’accroissement de la population. Il y a un déficit structurel des effectifs et ça c’est un facteur objectif qui est là».
Ils sont nombreux à observer, comme le commissaire Boubacar Sadio, que les régimes qui se sont succédé à la tête de l’Etat, ont étalé leur incompétence et mis en avant une véritable absence de vision en matière de sécurité. Si Senghor s’est contenté de la nomenclature et de l’architecture que les colons lui ont laissées en faisant avec, ses successeurs ont petitement innové. En galvaudant les termes de la Constitution, les tenants du pouvoir semblent avoir limité la sécurité dans la capitale à la «bunkerisation» du palais de la République, à un matraquage des opposants téméraires et à l’installation de quelques commissariats où les populations peuvent épandre leurs complaintes. Le tout, tissé dans une toile façonnée par des services de renseignements, certes efficaces mais, dont les rapports et autres bulletins ne sont intéressants que quand ils portent la mention «urgent».
Pressé par les institutions de Bretton Woods, Abdou Diouf a plus appréhendé la question de la sécurité par la soustraction. «Abdou Diouf a une responsabilité personnelle dans ce qui se passe en ce moment. Il a radié tout un corps, ce qui a causé le déficit qu’on est en train de vivre en ce moment d’autant qu’après cette radiation de 1987, il était ensuite resté six ans sans recruter un seul policier tellement il en voulait à la police», rappelle le commissaire Sadio. Pour beaucoup de policiers, le régime socialiste, sous Abdou Diouf, sans mettre en exécution une véritable politique de sécurité, a totalement ramolli leur état d’esprit en manifestant en outre une nette préférence pour la gendarmerie. Si avec Me Wade, les policiers ont été quelque peu réhabilités, le nouvel élu n’ira pas plus loin que son prédécesseur. Les policiers qui sont principalement chargés de la sécurité dans la capitale, retrouvent le sourire, leur condition améliorée, sans que la sécurité des citoyens ne soit davantage garantie.
Mais si les conditions de vie des policiers seront légèrement améliorées, il n’en sera pas de même de leurs conditions de travail. Et c’est là le bât blesse, selon l’ancien directeur adjoint de la police nationale. D’abord, le sous-effectif est si criard que la norme qui voudrait qu’un poste de police fonctionnât vingt-quatre heures sur vingt-quatre avec en permanence treize policiers en fonction, est royalement ignorée. Ainsi, trouver plus de trois éléments en fonction la nuit dans un poste de police est rarissime. La situation est telle que la police semble avoir abandonné les patrouilles régulières, leur préférant des opérations coup de poing super médiatisées qui ne sont pas d’un grand effet sur l’insécurité qui n’en demeure pas moins galopante. «Combien de postes de police de proximité aurait-on pu créer avec les dizaines de milliards de francs consacrés à la construction de l’arène nationale et combien de policiers aurait-on pu recruter en les dotant de suffisamment de véhicules et de carburant avec une telle enveloppe ?», se demande peiné le commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle à la retraite, Boubacar Sadio. Seulement voilà : les autorités préfèrent doter à coup de milliards les lutteurs d’une arène où ils pourront jouer aux gladiateurs chaque week-end et se départir d’une de leurs missions régaliennes, celle d’assurer la sécurité des personnes et des biens.
La police, le parent pauvre d’un système démuni
Dans le dispositif de sécurité du Sénégal, la police est en première ligne. Elle a pour mission : «La sécurité et la paix publiques, consistant à veiller à l’exécution des lois, à assurer la protection des personnes et des biens, à prévenir les troubles à l’ordre public et à la tranquillité publique ainsi que la délinquance ; la police judiciaire, ayant pour objet, sous la direction, le contrôle et la surveillance de l’autorité judiciaire, de rechercher et de constater les infractions pénales, d’en rassembler les preuves, d’en rechercher les auteurs et leurs complices, de les arrêter et de les déférer aux autorités judiciaires compétentes. Le renseignement et l’information, permettant d’assurer l’information des autorités gouvernementales, de déceler et de prévenir toute menace susceptible de porter atteinte à l’ordre public, aux institutions, aux intérêts fondamentaux de la Nation ou à la souveraineté nationale». Si c’est grandiloquent ainsi libellé , dans les faits, il n’en est presque rien.
Si la police peut se targuer d’un taux d’élucidation des meurtres de plus de 90 %, pour ce qui concerne la protection des personnes et des biens, elle est totalement démunie pour pouvoir agir efficacement. «Il y a d’abord un déficit structurel des effectifs. La police n’a pas les moyens humains pour remplir correctement les missions à elle confiées par l’autorité», explique le commissaire Boubacar Sadio. En plus de ce déficit qui entrave l’efficacité de la police, il y a les moyens logistiques qui font grandement défaut. Le 17 qui permettait aux citoyens de se faire secourir n’a plus grande utilité. «Aujourd’hui, vous allez dans les commissariats de police, les gens n’ont plus de capacité d’intervention. On te dit que le véhicule est là, mais il n’y a pas de carburant ou bien la voiture est en panne. Ou on te dit, on ne peut pas venir parce que nous ne sommes que deux alors qu’il doit y avoir en permanence au minimum sept», renchérit l’ancien Directeur général adjoint de la Police nationale. En sous-effectif et sous-équipée, la police a depuis longtemps abandonné les rondes et les patrouilles. Et pourtant, renseigne le commissaire, «les patrouilles rassurent les citoyens et les tranquillisent. Tout comme elles dissuadent les potentiels malfrats. Elles entrent dans le cadre de la prévention». Seulement, ne pouvant pas intervenir en cas de besoin, la police ne saurait exceller dans l’anticipation. En lieu et place des patrouilles, ce sont des rafles devant les caméras qui sont organisées pour mettre en avant tel ou tel commissaire pressé de gravir les échelons.
Depuis qu’ils ont bravé le régime d’Abdou Diouf, en marchant sur le Palais de la République, les policiers sont les parents pauvres d’un système qu’ils sont pourtant les premiers à défendre. Savez-vous que les policiers n’avaient jamais auparavant siégé au Conseil national de sécurité (Cns), organe qui se réunit chaque lundi et qui assiste et conseille le président de la République dans les domaines relevant de la sécurité nationale. Ce ne fut le cas ni avec Abdou Diouf, ni avec Abdoulaye Wade. Ce n’est qu’avec le président Macky Sall avec le décret n° 2013-1152 du 20 août 2013 relatif au Conseil national de sécurité (Cns) qu’ils ont eu le droit d’y siéger.
L’Agence d’Assistance à la sécurité de proximité, une fausse solution
Arrivé au pouvoir, le président Macy Sall, à défaut de redorer le blason de la police en lui dotant de réels moyens, a cherché à étoffer le dispositif de sécurité. Avec le Décret n° 2013-1063 du 5 août 2013, il crée et fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence d’assistance à la sécurité de proximité (Asp). Comme missions, il a été assigné à l’Agence de participer, en relation avec les autorités de police et les forces de sécurité (Police et Gendarmerie), à la mise en œuvre d’une police sécuritaire de proximité bâtie autour de la prévention et du partenariat actif entre l’Etat, les Collectivités locales et les acteurs de la vie sociale. A ce titre, elle est chargée de : participer à l’élaboration et à la mise en œuvre, en rapport avec les différents acteurs, du plan national de prévention et de lutte contre la délinquance ; participer à la mise en place de contrats locaux de sécurité en relation avec les comités départements de prévention et de lutte contre la délinquance.
Après trois ans, il est difficile de dire en quoi cette Asp a participé à sécuriser les populations. Ceux qui s’attendaient à voir ses éléments arpenter les artères des quartiers cherchant à sécuriser les citoyens, vont déchanter au fur et à mesure qu’ils sont déployés sur le terrain. Les quelques agents qui sortent du lot, se font remarquer dans des délits qu’ils ont commis. Le 12 février 2015, le Directeur de l’Agence Niang révélait avoir limogé 150 assistants de la sécurité de proximité. «Certains d’entre eux ne vont pas au travail et d’autres ont maille avec la justice», s’était-il contenté de dire. Et ce n’était que l’arbre qui cache la forêt. Dans beaucoup de commissariats, dorment des piles de dossiers incriminant des assistants de la sécurité de proximité. Si le résultat est aussi lamentable, c’est que la mission de l’Agence est totalement dévoyée. Recrutés pour la plupart par copinage et camaraderie ou sur la base politique, puis dispersés à Dakar et dans les régions, les Assistants de la sécurité de proximité (Asp), formés comme des agents de sécurité mais n’ayant pas les prérogatives d’un vigile, sont transformés en courtiers, chauffeurs, boys etc. Une condition que beaucoup d’entre eux n’ont pu accepter, préférant retourner rallonger la liste kilométrique des chômeurs.
Avec 10 000 éléments recrutés, Macky Sall semble avoir atteint son véritable objectif : pouvoir se targuer d’autant d’emplois créés. Pour le reste, c’est son ancien adversaire politique et actuel ami qui gère frustrant policiers et gendarmes. Dans certains cercles, il se susurre que le directeur de l’Agence a une rémunération supérieure à celle du directeur général de la police nationale qui n’a été revalorisée que dernièrement. Une situation que l’on peine à comprendre du côté de la place Washington.
L’Agence placée sous la tutelle technique du ministère de l’Intérieur et sous celle financière du ministère de l’Economie et des Finances est, en soi, une très bonne idée selon de nombreux spécialistes. Seulement, appelée à jouer le rôle d’une police municipale, elle se présente comme une vraie fausse solution. Et pour Macky Sall, plus enclin à la lutte contre le terrorisme qu’à la sécurisation des citoyens, les cris de populations endeuillées, résonnant jusqu’à faire écho à la présidence de la République, vont rappeler la mission d’un chef d’Etat. Et à défaut de vouloir assister une population qui prend en charge sa propre sécurité, avec le risque d’instaurer un far West dans les quartiers, il est temps d’agir.
Par Mame Birame WATHIE